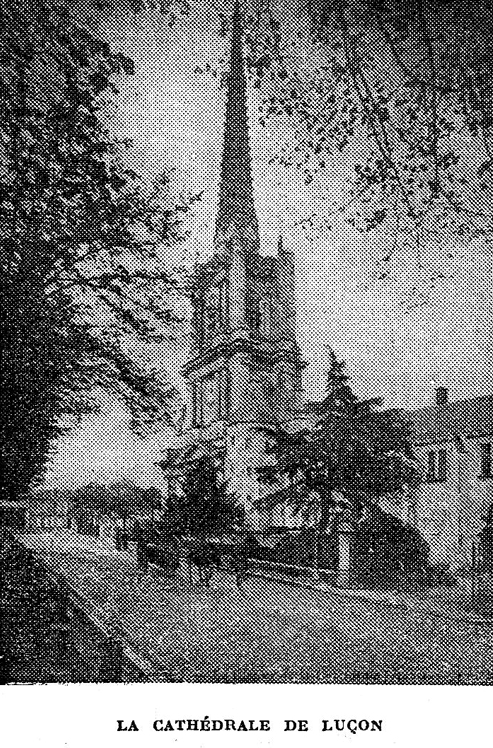Lorsque tout est Fini...
Georges Millandy
Souvenirs d'un chansonnier du Quartier Latin.
PARIS
ALBERT MESSEIN, EDITEUR
19, Quai Saint-Michel, 19 1933
Préface de GUSTAVE FRÉJAVILLE
TABLE DES MATIERES
___________
|
Lorsque tout est fini...
MÉMOIRES D'UN PARESSEUX
I.
Dans les jardins de ma petite ville
C'est dans le grand Jardin où, calme et isolée,
Inquiète déjà des demains soucieux,
Mon enfance s'est écoulée...
La lune, maintenant, blanchit la grande allée,
Les étoiles là-haut, semblent de beaux grands yeux.
Me suis-je pas soudain, surpris à leur sourire ?
Le vent du soir qui parmi les branches, soupire,
A des chuchotements doux comme des aveux,
Et quand un souffle passe, effleurant mes cheveux,
C'est comme une caresse à mon front en délire...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En moi, des chants d'amour pleurent mystérieux !
Ces vers, écrits sur la première page de mon petit livre, Les Frêles Chansons, chantent en ma mémoire, au moment où j'évoque le temps lointain de mon enfance. Je revois la verte pelouse bordée de lierre, les corbeilles aux mille couleurs, les arbustes d'essence rare, les palmiers et les orangers qui, dans la grande serre, mêlaient leur parfum douce?tre à l'?cre odeur des cigares, et dominant les grands arbres qui formaient le fond du décor, la flèche svelte de la cathédrale toute proche, autour de laquelle des nuées de corneilles tournaient en croassant...
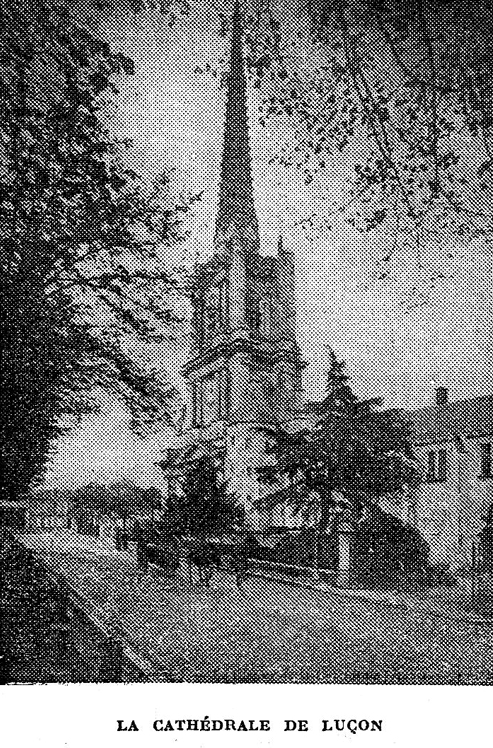
C'est dans ce jardin merveilleux que s'écoula mon enfance ; c'est sur le sable de ses allées que j'ai risqué mes premiers pas ; c'est parmi ces fleurs que j'ai rêvé mes premiers rêves ; c'est derrière ses massifs que j'ai caché mes premiers émois.
Je ne sortais de mon jardin que pour aller courir dans un autre parc, plus vaste, qu'un riche bourgeois de la ville, M. Dumaine, avait abandonné à ses compatriotes. Un mien oncle avait voulu l'acquérir en même temps que la maison dont il dépendait, qu'il croyait pouvoir restaurer, agrandir et sans doute enlaidir à son gré ; mais le père Dumaine avait stipulé dans son testament, que rien ne serait changé dans l'aménagement de la vieille demeure. La maison fut achetée par la ville, la mairie y installa ses services, et le jardin Dumaine fut ouvert aux promeneurs.
J'aimais la majesté de ce parc, ses vastes pelouses, ses allées ombreuses, ses paons orgueilleux, ses biches craintives, son cèdre trois fois centenaire et ses ifs pareils à des blocs de vert granit et que l'on e?t dit sculptés par quelque habile artiste. Mais je déplorais que l'eau manqu?t dans la propriété, et il me souvient qu'à quinze ans je rimais, sur l'air du Temps des Cerises, des couplets, pas méchants ; mais que je devais croire terriblement rosses :
Quand il y'aura d' l'eau dans l'Jardin Dumaine,
Ce s'ra pour la Ville un charme nouveau ;
Or, elle en est pleine...
Les pauv's amoureux, le cœur gros de peine,
Y viendront, rêveurs, fair' des ronds-dans-l'eau.
Ils pourront s' noyer, tout comm' dans la Seine,
Dans l' Jardin Dumaine, quand il y'aura d' l'eau.
Il y a, aujourd'hui, dans le grand jardin, un magnifique étang ; mais il y a aussi un horrible pont de ciment et d'affreux rochers que l'on dirait en carton-p?te, et près du kiosque inévitable, un bassin ridicule, avec, au milieu, une dame de bronze qui sourit sous une vasque en forme de parapluie !
Et je regrette le petit pont de mon enfance, le petit pont de bois vermoulu, inutile et charmant, et les grandes pelouses que nul bassin n'enlaidissait, et qui s'étendaient pareilles à d'immenses tapis verts sur lesquels il était défendu de "marcher sous peine d'amendes".
II.
La maison du marquis. - Une singulière officine.
Le décor sévère de notre vieille maison n'était pas pour égayer ma jeune imagination... C'était une vaste habitation qui tenait de la gentilhommière et de l'officine. Mon grand-père, pratique apothicaire, n'avait pas hésité à en g?ter l'élégante ordonnance en installant, dans tous les coins, d'affreux placards où s'entassaient paquets et flacons. Pourtant, il n'avait pas réussi à enlever à l'antique demeure son aspect quasi-seigneurial.
Dans le haut vestibule, un large escalier de pierre à rampe de fer forgé donnait accès aux chambres alignées sur un froid couloir et qui me semblaient tristes comme des cellules monacales.
Une odeur ?cre et douce?tre à la fois, montait, par bouffées, de la pharmacie voisine, se répandait dans les corridors, pénétrait jusque dans le salon dit "de compagnie", mêlant des relents de formol, d'éther et d'iodoforme au parfum des fleurs dont les pièces étaient garnies en toutes les saisons.
Pour complaire à sa famille et conserver une officine qu'on lui avait léguée comme un bien précieux, mon père avait d? troquer le ciseau du sculpteur contre le pilon dit potard et vivait là, résigné, au milieu de ses bocaux. Pourtant, il lui arrivait d'oublier, pendant quelques instants, pilules et potions, et je l'ai plusieurs fois surpris égayant d'un croquis les marges de son livre de comptes, on modelant dans la glaise quelque amusante figurine. Quand il était en veine de confidences, il parlait avec attendrissement de ses amis Clairville et Siraudin et des chanteurs fameux qu'il avait connus du temps qu'il habitait 4, Paris, rue des Fossés-Saint-Germain, aujourd'hui rue Monsieur-le-Prince.
J'écoutais, de toutes mes oreilles, les histoires de thé?tre qu'il aimait à répéter. Avec lui, je pénétrais dans les coulisses du Palais-Royal ou du Thé?tre des Italiens, et je me croyais transporté sur le plateau de l'Opéra-Comique, en l'entendant fredonner le grand air de la Traviata ou les couplets des Noces de Jeannette, dont il savait par cœur la partition.
Le curieux apothicaire !
"Vous avez un rhume, ma brave femme ? Croquez ces pastilles et mettez-vous au lit. Cela vous co?tera moins cher et vous guérira plus s?rement que toutes les drogues que vous pourriez acheter !" C'est ainsi que l'excellent homme entendait les affaires.
La pharmacie - la boîte, disait mon père - ne rappelait aucunement les boutiques poisseuses et étriquées que l'on trouve encore en province et qui ressemblait pas davantage, aux comptoirs des modernes pharmacies qui font penser à une succursale de banque ou à une épicerie nouveau style. La boîte avait grand air, avec ses bocaux dorés et ses hauts' bahuts artistement sculptés qu'éclairaient des lampes massives. Autour de la pièce, dans de spacieuses vitrines, une collection d'animaux empaillés renards, tigres, écureuils, paons, oiseaux des îles, papillons rares, rappelait que mon grand-père, médecin-apothicaire, avait été, par. surcroît, naturaliste.
Sans doute, quelques-unes de ces pièces avaient-elles été rapportées de lointains pays, par mon bisa?eul, médecin de marine et chirurgien, qui, un jour, las de naviguer, s'était fixé dans la petite ville de Lu?on, b?tie à l'entrée des marais, pour y combattre les fièvres paludéennes qui désolaient alors la contrée.
J'imaginais les merveilleux voyages du navigateur, et regardais avec admiration les beaux uniformes brodés d'or et les sabres gainés de cuir ouvragé, pieusement conservés au fond d'un grand placard qui sentait le camphre et la naphtaline...
Les laboratoires ne m'impressionnaient pas moins. Des appareils bizarres : alambics compliqués, cornues de toutes formes, mortiers de toutes tailles, encombraient les étagères, et des fourneaux br?lés par de multiples cuissons attestaient que l'on avait fabriqué là, pendant des années, mille drogues que l'on trouve aujourd'hui, toutes préparées et soigneusement empaquetées, chez l'épicier-pharmacien.
Je devinais que mon bisa?eul avait d? posséder une jolie fortune et occuper une importante situation. (J'ai retrouvé son nom, parmi ceux des notables, sur plusieurs actes civils.) C'est lui qui avait acquis d'un certain marquis des Couteaux, notre maison, la plus importante de la ville.
Ce marquis, chevalier de Saint-Louis, commandant des canonniers garde-côtes, grand chasseur et intrépide cavalier, était, paraît-il, un drôle d'homme. J'ai ou? dire qu'il montait à cheval le grand escalier de sa demeure et qu'il ne quittait les étriers qu'à la porte de sa chambre, pour chausser ses pantoufles... On contait devant moi, quand j'étais enfant, bien d'autres choses étonnantes ! N'affirmait-on pas que les caves profondes de la vieille maison conduisaient aux portes secrètes de la cathédrale et que, dans ces souterrains, le terrible commandant faisait enfermer les contrebandiers capturés sur la côte ?...
Ces histoires effrayantes trottaient dans ma cervelle et, la nuit venue, dans le silence de ma petite chambre, il me semblait entendre sonner sur les dalles, les bottes du marquis errant par les couloirs !...
J'éprouvais, on le comprendra, le besoin de m'évader de ce décor. Dès que le déjeuner était achevé, quand le mauvais temps me chassait du jardin, je grimpais dans les greniers les plus élevés et les plus retirés où la lumière m'arrivait plus vive et où il me semblait vivre une autre vie, loin des domestiques bruyants et des visiteurs importuns. C'est là que j'ai griffonné mes premiers vers.
J'aurais à tout jamais oublié tant d'ingénus essais depuis longtemps jetés au feu, si un mien ami ne m'avait remis en mémoire un poème (!) que je lui avais dédié quand j'avais seize ans et qu'il avait précieusement conservé.
Devenu directeur d'un magazine parisien, ?mile Chabanier me demanda, un jour, l'autorisation de publier ces vers de ma prime jeunesse.
Je parcourus, en souriant, mais non sans émotion, les épreuves de cette petite pièce combien élégiaque, où il était question de rêves défunts, de fleurs et de petits oiseaux. Cela s'intitulait Dernier Printemps et se terminait par ce tableau de la campagne rassérénée après la tempête :
Un silence profond succédait à l'orage...
Dans les prés reverdis, sous le sombre feuillage,
Tout semblait reposer en un calme sommeil ;
Le pinson, maintenant, suspendait son ramage,
Et dans les champs semés d'azur et de vermeil,
Des larmes de l'aurore,
La fleur humide encore,
Attendait pour éclore
Un rayon de soleil...
[?]
Cependant le soleil avait percé la nue,
Les gros nuages noirs avaient fui sans retour,
Et de quelque côté que se port?t la vue
Tout semblait redoubler d'allégresse et d'amour!
Au souffle du zéphyr, penché parmi l'herbette,
Le bouton d'or, parfois, baisait la p?querette;
L'hirondelle venait, avec cent petits cris,
De son aile d'azur caresser les épis ;
L'églantine superbe, et l'humble violette
Confondaient en les airs leurs plus douces senteurs,
Tous les oiseaux chantaient dans les buissons en fleurs !
Avez-vous remarqué que les premiers vers d'un poète sont le plus souvent des vers descriptifs ? Je devais, comme les autres, brosser mon petit tableau ; mais cette œuvrette na?ve est, je crois bien,
le seul poème pictural que j'aie écrit de ma vie.
III.
En cueillant des mûres. Ce drôle de Gaborit.
? seize ans, j'avais déjà g?ché de nombreuses feuilles de papier chipées dans les tiroirs de la pharmacie ; mais, jamais encore, l'idée ne m'était venue de rimer des couplets... Sans doute, comprenais-je déjà, que l'art du chansonnier est le plus difficile : celui qui exige les dons les plus nombreux et les plus rares.
Les chansons dont les paroles na?ves et les airs simplets s'inscrivirent les premiers dans ma mémoire sont celles que m'apprit une petite servante campagnarde, là-bas, dans un village perdu au fond
du bocage vendéen. J'ai, depuis, entendu beaucoup d'autres refrains d'une na?veté charmante ; aucun ne m'a plus profondément troublé que ces complaintes que la petite bonne disait d'un ton traînard, en me menant promener par les chemins creux, le long des buissons lourds de mûres et chargés d'aubépine.

Tous les ans, quand arrivait la belle saison, on nous emmenait, ma sœur, mon frère et moi, passer les vacances en pleine campagne, au Boupère, chez une vieille tante, la tante Bodin, qui vivait là, bien tranquille, en compagnie d'Augustine, sa fidèle servante.
Chaque an0née, la même voiture fatiguée - un vieil omnibus désaffecté sur lequel on pouvait lire encore : "Bagages à domicile, service à volonté" - était mis à notre disposition. Les hautes malles et les innombrables paquets entassés sur la bagnole achevaient de donner à l'équipage un air ridicule et charmant d'antique diligence. Après mille recommandations faites aux domestiques auxquels on confiait la garde de la maison, on s'empilait là-dedans le mieux que l'on pouvait, et la patache s'ébranlait enfin, au milieu d'un nuage de poussière, dans un grand bruit de grelots fêlés...
On passait par Pouzauges et, après un voyage de dix grandes heures sur des chemins "montants, sablonneux, malaisés", on arrivait au Boupère à la nuit tombante, au milieu des cris des gamins, des aboiements des chiens et de l'effarement des oies et des canards.
Mme Bodin, qui vingt fois déjà avait cru entendre le bruit des grelots sur la route, nous attendait devant sa porte, le sourire épanoui derrière les tire-bouchons jaun?tres qui s'échappaient de son bonnet de dentelle.

La bonne tante s'affairait : "Allons, vite, Gustine ! Vite, de la limonade, du sirop d'orgeat !... Ils doivent mourir de soif, ces enfants, après un pareil voyage !..." Et les lourdes malles et tous les paquets étaient à peine déposés dans le vestibule que déjà nous étions installés dans la grande salle à manger, cirée en notre honneur et toute parfumée d'une insupportable odeur d'encaustique.
"Et au Boupère, ma bonne tante, quoi de nouveau ?"
"Oh ! des tas de choses, mes enfants !... La fille de Morineau s'est mariée... Vous savez bien... Morineau... le marchand de bonnets, sur la place !... Gustine est allée à la noce... Ah ! et puis... et puis que je vous dise... Gaborit... vous savez bien, voyons... ce drôle de Gaborit... le fils de mon jardinier qui lan?ait des pierres dans mes carreaux... eh bien, mes enfants, il est entré au séminaire, et maintenant il est abbé... mais oui, mes bons enfants... avec une soutane... un vrai abbé !... Figurez-vous que, l'autre matin, il est passé sous ma fenêtre et il m'a dit?: "Bonjour, madame Bodin !?" Et, dame, je lui ai répondu, je lui ai dit: "Bonjour, monsieur l'abbé !?" Gustine s'est moquée de moi : "Comment, madame, vous ne le reconnaissez pas ?... Mais c'est Gaborit... ce drôle de Gaborit qui cassait tous vos carreaux !?" Oui, mes enfants, c'était lui !?"
Et la bonne tante n'en revenait pas "Ah ! non, ?a, c'est trop fort ! Gaborit ! ce drôle de Gaborit que j ai appelé "monsieur?" !...

Cette année-là, il fut décidé que nous n'irions pas au Boupère... La bonne tante était souffrante et l'on craignait de la fatiguer.
Nous avions à regret renoncé au voyage, quand nous re?ûmes une lettre d'Augustine. L'état de Madame "s'était empirée", disait la lettre, et l'on avait peur que la malade ne "passe pas la semaine". Le médecin nous faisait savoir qu'il était grand temps de venir si nous voulions, une dernière fois, voir Mme Bodin.
Nous arriv?mes le lendemain. La voiture fut arrêtée à l'auberge, près de l'église. Augustine était venue au-devant de nous, les yeux rougis par les larmes. Ce m'était plus qu'une affaire de quelques heures, avait dit le médecin. Madame était au plus bas ; et il fallait nous h?ter...
Nous fûmes autorisés à entrer dans la chambre de la malade à la condition que nous ne ferions pas de bruit. Sur la pointe des pieds, en évitait de faire craquer le plancher, nous nous approch?mes doucement et nous aper?ûmes, dans le lit à colonnes, la pauvre tête de la bonne tante, toute blanche sur l'oreiller.
Cependant ; la malade 's'affaiblissait de plus en plus... Un prêtre fut mandé en h?te. Ce fut l'abbé Gaborit qui se présenta... "?Madame Bodin, dit-il, voici le moment venu d'aller chez le bon Dieu:.."
La vieille dame entr'ouvrit les yeux et reconnut l'abbé.
Dans un souffle, elle murmura?: "Ah ! c'est toi, Gaborit...?" Et ce fut tout. L'abbé vit que les forces l'abandonnaient : "?Ma fille, pronon?a-t-il, faites votre acte de contrition et dites
"Mon père, je m'accuse..."
Mme Bodin ne répondit pas ; mais un sourire malicieux plissa ses lèvres p?les, et nous comprîmes qu'elle pensait : "Ah ! non, ?a, c'est trop fort ! Gaborit ! ce drôle de Gaborit qui veut que je l'appelle "mon père !"

Je re?us un jour - il y a de nombreuses années - une lettre de mon ami le poète Jacques Dyssord qui était alors attaché à un important journal du soir.
Dyssord commen?ait une intéressante enquête.
"?Quel est, me demandait-il, votre plus joli souvenir de vacances ? Je pose la question à quelques écrivains et il me serait agréable d'avoir, sous la forme d'une nouvelle, une réponse de vous."
Je me rappelai mes vacances au Boupère, et j'envoyai à Dyssord, la petite histoire que je viens de vous conter.
Qu'arriva-t-il ?.. Je n'ai plus entendu parler de l'enquête et suis resté sans nouvelles de l'enquêteur.
Mais je n'ai oublié ni la tante Bodin, ni l'abbé Gaborit ; ni la petite bonne qui, le long des routes, chantait de si jolies chansons, et j'ai pensé que cette histoire véridique avait sa place tout indiquée parmi ces souvenirs.
IV.
En marge des classiques. - Adrien Dézamy, Alfred Leroux, le père Gillet. - Pour une tache d'encre.
Mes goûts littéraires n'étaient pas encouragés par ma famille. Sans doute avait-elle, pour cela, de bonnes raisons :..
La clef d'une vieille bibliothèque reléguée au fond d'un grenier et qui (je l'ai su plus tard) recelait, à côté de nombreux ouvrages médicaux, de petits vers galants, m'était soigneusement cachée. Les seuls livres que l'on me permit de feuilleter étaient ceux qui garnissaient, de haut en bas, les murs du sévère bureau de l'oncle Alfred, sénateur de la Vendée et frère d'Edmond Biré, l'auteur de La Légende des Girondins, du Journal d'un Bourgeois de Paris sous la Terreur, de Victor Hugo intime, etc.
La lecture de ces doctes ouvrages ne m'enchantait guère. J'avais beau savoir que l'oncle Edmond "avait tracé des voies nouvelles à la critique en la dégageant des broussailles de la légende, et en détruisant les mauvaises herbes de l'erreur et de l'exagération...?" (Le Phare de la Loire.) J'avais beau me rappeler qu'il était titulaire du Prix Montyon, du Prix Guizot, du Prix Gobert, et de bien d'autres encore, je n'arrivai pas à trouver un suffisant aliment à mon imagination dans cette documentation un peu sèche, en dépit des "rosseries" que le malicieux critique s'était amusé à y glisser.
En vain je cherchais, parmi tant de bouquins, les œuvres des poètes modernes. Aux environs de 1885, je ne connaissais de nos richesses poétiques que les "morceaux choisis", rapportés du collège et les petits vers qu'Adrien Dézamy rimait dans le Monde illustré, en manière de légende, sous les tableaux les plus remarqués des salons de peinture.
Adrien Dézamy, fils d'un cordonnier Lu?onnais, parti de bonne heure chercher la gloire à Paris, connaissait la célébrité. Les mauvaises langues assuraient qu'il usait et abusait des faveurs de Marguerite Ugalde, alors dans tout l'éclat de sa renommée. Mon père parlait de lui comme d'un assez mauvais sujet, tout en lui reconnaissant un "gentil talent".
Il n'en fallait pas davantage pour me donner l'envie d'imiter sa manière, et dans mon petit cabinet de travail, au lieu de me fourrer dans la tête les dates des grandes batailles ou le nom des fleuves et des affluents, je m'amusais à orner de légendes rimées, les chromos libertins dont j'avais tapissé les murs.
Un autre poète de l'endroit - un humoriste, celui-là - m'intriguait singulièrement. C'était un grand diable d'homme aux cheveux gris en broussaille qui menait, dans la paisible petite ville, la vie désordonnée d'un bohème incorrigible. Ses parrains, aimables farceurs, l'avaient prénommé Roch, Loup, Clou, Pantaléon.
Roch-Loup-Clou-Pantaléon Gillet, rimeur de pamphlets et de couplets gaillards, jouait les Ange Pitou au Café du Commerce et, le jour du Mardi-Gras, faisait le pitre sur la place du Marché, tel un charlatan de foire, avec, ma foi, beaucoup d'esprit !
Le père Gillet n'était pas seulement un poète, c'était aussi un commer?ant avisé qui avait le sens de la publicité. J'admire encore aujourd'hui la simplicité adroite de ce quatrain dont s'adornaient ses flacons de moutarde, et qui eût mis en joie M. Paul Reboux?:
Je réveille
? merveille,
Un petit
Appétit !
A présent, un besoin de lire, d'apprendre, commen?ait à me torturer.
Un jour que, délaissant mes devoirs de vacances, je m'étais aventuré dans une soupente encore inexplorée, je découvris, gris de poussière et voilé de toiles d'araignées, un vieux bahut dans lequel étaient empilés deux ou trois cents bouquins jaunis par le temps et grignotés par les rats.
La plupart étaient des romans d'aventures et de vieux ouvrages dramatiques. Quelques plaquettes de vers, hommages de poètes inconnus, ornées de dédicaces aussi flatteuses que ridicules, s'y trouvaient mêlées. Je les parcourais distraitement, lorsque je tombai sur un grand volume relié en parchemin qui sentait le moisi et les fleurs séchées. C'était un recueil de poésies qui avait pour titre L'Herbier. L'auteur en était Alfred Leroux, cousin de mon père ; ancien ministre sous l'Empire et vice-président de la Chambre. Une belle eau-forte représentant une délicieuse jeune fille dans un décor de noirs sapins illustrait le volume.

Plusieurs poèmes étaient dédiés à M. de Ch?teaubriand, à Alfred de Musset et à son ami Alfred Tattet. Toute la tristesse romantique se retrouvait dans ces vers : je les lus avec avidité. Je me sentais étourdi, enivré, effrayé aussi... Ma sensibilité s'éveillait au contact de l'?me du poète. Jusqu'ici, je m'étais amusé à composer des œuvrettes légères à la manière de Dézamy ! voici qu'à mon tour, je sentais l'impérieux besoin de pleurer de vagues chagrins et de chanter d'imprécis espoirs. Faute de connaître l'amour, j'en imaginais les joies et les tourments, et c'est à la symbolique Colombine que j'adressais mes premiers aveux et mes premiers serments.
Colombine, Ma Colombine !
C'est Pierrot qui soupire ainsi,
Pierrot qui, d'amour tout transi,
Demande s'il n'est point ici
Quelqu'un qui l'aime et le c?line.
Colombine, Ma Colombine !
Il pleut. Mon crœur est désolé.
Mon chant par mes pleurs est voilé,
Et l'averse a désaccordé
Les cordes de ma mandoline...

Cependant les années passaient. La date redoutée du bachot était proche, et une immense angoisse m'envahit... Si j'allais être recalé ! Quelle honte pour les miens !
Ah ! quel soulagement je ressentis quand j'eus traduit en me jouant ma version latine ; écrit d'un jet ma composition fran?aise et b?clé ma version anglaise ! Quel soulagement ! Mais aussi quelle tristesse ! Adieu ; mes rêves de poète ! C'en était fait ! Moi aussi j'allais être pharmacien, pharmacien de première classe !...
Et, sans plus penser à ma copie, je me mis à rimailler pour tuer le temps
Quand je serai potard
En ma ville natale,
Loin de la foule et du pétard,
Loin de ta joie, ô Capitale !
Poète comme avant,
En dépit d'Hippocrate,
Je vieillirai savant
Dans la poudre et la p?te...
Du matin jusques au soir,
Debout derrière un comptoir,
Curieux apothicaire !
Plaignant les pauvres humains,
Je rimerai des quatrains
En préparant leurs clystères.
Et tout comme autrefois, songeant
Aux papillons, aux libellules,
Je ferai de belles pilules
Couleur d'argent...
Soudain, l'appariteur annon?a : "Messieurs, vous n'avez plus que deux minutes !" Je me levai d'un bond ; en h?te, je ramassai mes feuillets et j'allais les remettre à l'appariteur, lorsque je heurtai du coude l'encrier qui se renversa et couvrit d'une large tache noire la belle version dont j'étais si fier.
Le résultat, vous l'avez deviné : un superbe zéro me fut octroyé, pour m'apprendre à être moins négligent et moins nerveux !
Un mois après, au lieu de m'envoyer à la campagne soigner mes nerfs, on m'enferma dans une de ces horribles boîtes à bachot où les cancres et les déveinards attendent patiemment que les examinateurs, las de les examiner, leur accordent, enfin, le parchemin convoité.
Ah ! la boîte Chevalier ! Ses locaux infects, ses dortoirs sinistres et sa cour désolée, où trois arbres étiques achevaient de mourir... J'ai vécu là les heures les plus tristes de mon existence, n'ayant pour camarade qu'un excellent gar?on à qui je passais mes compositions fran?aises en échange des thèmes qui étaient sa spécialité. Mon ami D... est aujourd'hui journaliste et secrétaire général d'un thé?tre. Je crois, Dieu me pardonne ! qu'il est aussi chansonnier !
Un jour (j'étais décidément incorrigible !) ne m'avisai-je pas de traduire en vers la version latine que l'on nous avait donnée comme devoir ? J'avais mon idée. Je savais que j'allais flatter la manie de notre professeur, un brave Méridional qui "taquinait la Muse" et nous avait invités à en faire autant, déclarant que c'était là un excellent exercice.
Je rougis de plaisir quand, le lendemain matin, M. Claudius Branchard annon?a que parmi les copies les meilleures s'en trouvait une écrite en vers et "qui dénotait chez son auteur - en dépit de quelques maladresses - un véritable tempérament de poète !"
La classe terminée, M. Branchard me fit appeler ; "Mon ami, me dit-il, j'ai tenu à vous complimenter devant vos camarades ; mais n'en concevez pas trop d'orgueil. Il vous faudra beaucoup travailler pour réussir. Je veux vous y aider... C'est demain dimanche, jour de sortie. Allez, sans plus attendre, voir de ma part, au Salon Lamartinien, mon ami Jules Canton, directeur de la revue La Lyre Universelle. C'est là tout près, rue Soufflot. Demandez à Canton de vous conseiller, priez-le de publier vos premiers vers, et... abonnez-vous."
V.
La lyre universelle. Le salon littéraire et philosophique de France
Le lendemain matin, dès huit heures, ayant endossé la redingote à godets et coiffé le "huit reflets" sans lesquels il n'était pas, alors, de véritable élégance, je me trouvais, par un beau soleil printanier, au milieu de la rue Soufflot. Pour me donner du cœur, j'entrai dans une p?tisserie et je me fis servir... un malaga. J'étais très ému... Dans quelques minutes, j'allais me trouver devant M. Jules Canton, directeur de La Lyre Universelle, revue poétique et lamartinienne ! Le Salon Littéraire et Philosophique de France était là, a quelques pas... Je l'imaginais vaste, merveilleusement décoré, meublé de divans profonds, garnis de mœlleux coussins. Mentalement, je repassai la jolie phrase que je me proposais de prononcer en me présentant "Monsieur le Directeur, vous voudrez bien excuser mon audace... mais M. Marius Branchard, votre collaborateur, votre ami, notre ami, a bien voulu m'assurer..."
Le reste, pensai-je, viendra tout seul.
Mon malaga avalé, je me dirigeai résolument vers l'immeuble indiqué : une haute maison moderne de six étages. J'interrogeai la concierge?:
- M. Jules Canton, s'il vous plaît ? La Lyre Universelle ?...
- M'sieu Canton ? C'est au sixième.
Je demeurai interloqué
- Au sixième ?...
-
Au sixième, que j' vous dis !
Je pensai : il habite un atelier. Le Salon doit être installé dans une véranda.
Je gravis les étages, les jambes molles, le cœur battant.
J'étais arrivé à un étroit couloir qui donnait accès à de modestes chambres. Je me décidai à frapper à une porte. Une voix bourrue grogna?:
- Qu'est-ce que c'est ?...
Et un gros homme apparut en chemise, dans l'huis entre-b?illé :
- Quoi ?,.. Qu'est-ce que vous voulez ?...
- M. Jules Canton... Le Salon Philosophique...
-
M'sieu Canton ! C'est pas ici, M'sieu Canton ! C'est au fond du couloir... Y a son nom sur la porte !... Savez pas lire ?... C'est idiot de déranger les gens à des heures pareilles !
Je n'eus pas le temps de m'excuser le gros homme m'avait fermé la porte au nez. J'allais m'en aller, navré, lorsque je découvris un petit carton jauni, sur lequel était collé le nom imprimé de M. Jules Canton avec, au-dessous, écrits à l'encre rouge, ces mots magiques : Salon Littéraire et Philosophique de France. Je frappai... Au bout d'un instant, un bruit de savates se fit entendre. La porte s'ouvrit discrètement, et je me trouvai devant un grand gar?on à la face émaciée, aux yeux glauques, lourds encore de sommeil, et dont les cheveux blond filasse tombaient en mèches folles sur le front inquiet.
Je faillis tomber à la renverse ! Ce pauvre diable, à la chemise douteuse et dont le pantalon enfilé en h?te s'affaissait sur des pantoufles usées jusqu'à la corde, c'était Lui ! Lui ! le directeur de La Lyre Universelle et le fondateur du Salon Littéraire et
Philosophique !...
J'essayai en vain de prononcer la belle phrase préparée. M. Canton, qui commen?ait à s'éveiller, vint à mon aide?:
-
C'est pour un abonnement ? demanda-t-il. C'est cinq francs.
-
Non... oui... certainement... bafouillai-je. Mais je n'avais pas prévu, et je n'ai pas aujourd'hui, en poche...
Qu'à cela ne tienne, mon jeune ami, trancha M. Canton, il suffira que vous remplissiez le petit bulletin que je vais aller chercher.
M. Canton disparut un instant. J'en profitai pour jeter un coup d'œil dans la pièce : une malheureuse petite chambre garnie de trois chaises boiteuses et d'un canapé fatigué, avec, sur une cheminée de stuck, le buste en pl?tre de M. de Lamartine, qui semblait bien embêté de se trouver là !
Cependant, M. Jules Canton était revenu et me tendait un porte-plume.
-
Pour la petite somme, ce sera quand vous voudrez ; mais de préférence dans l'après-midi, parce que je me couche très tard.
Je crus le moment venu de faire connaître l'objet de ma visite.
M. Marius Branchard, dis-je, votre collaborateur... votre ami, notre ami, a bien voulu...
-
Ah ! c'est pour une collaboration ? Fort bien ! Vous avez vos poèmes ? Laissez-moi ?a... Vous pourrez, je pense, paraître dans le prochain numéro. Au revoir, monsieur, et à bientôt, n'est-ce pas, pour la petite somme ?
Je demeurai un instant stupide, dans l'étroit couloir, me demandant si je devais rire ou pleurer. Je venais de connaître ma première désillusion !

"Vous trouverez la revue sous les galeries de l'Odéon", m'avait dit M. Canton.
Avec quelle impatience j'attendis le dimanche suivant !
A huit heures, j'étais devant le thé?tre, inspectant l'étalage des libraires !... Soudain, j'aper?us, à côté de vingt autres revues plus luxueuses, un modeste petit fascicule de couleur verte, sur lequel se détachait, en majuscules, ce titre pompeux : La Lyre Universelle. Je l'ouvris d'une main tremblante. "Pourvu qu'il y soit !" pensai-je. Il y était ! Relégué dans un petit coin, à la dernière page, mais il y était, imprimé, signé !
Ma joie fut de courte durée : ne venais-je pas de découvrir sur la première page, cet avis : "Tout abonné a droit à une collaboration en prose et en vers". Ainsi, il suffisait... Je me sentis un peu humilié.
Je me décidai pourtant à envoyer à M. Jules Canton un nouveau poème ; mais je négligeai de joindre le montant de l'abonnement...

J'étais venu passer quelques jours dans ma lointaine Vendée, lorsqu'un beau matin, mon père re?ut une lettre de M. Jules Canton qui, je ne sais comment, avait découvert l'adresse de ma famille.
"Monsieur, écrivait-il, j'ai eu l'honneur de publier les premières œuvres de Monsieur votre fils. Il avait été convenu qu'il me ferait parvenir le prix de l'abonnement pour une année. Je n'ai rien re?u ! Votre fils reconnaît mal les bontés que j'ai eues pour lui. Je viens vous prier, Monsieur, de bien vouloir m'envoyer en un mandat-poste... etc."
C'est de cette fa?on que ma famille apprit mes débuts dans la carrière littéraire. Ai-je besoin de dire qu'elle ne crut pas devoir encourager une vocation qui mena?ait de lui coûter cher ?
Je dus promettre de cesser ma collaboration à La Lyre universelle et jurer de ne plus jamais m'abonner à une revue poétique, fût-elle lamertienne. J'ai tenu parole !

  
|